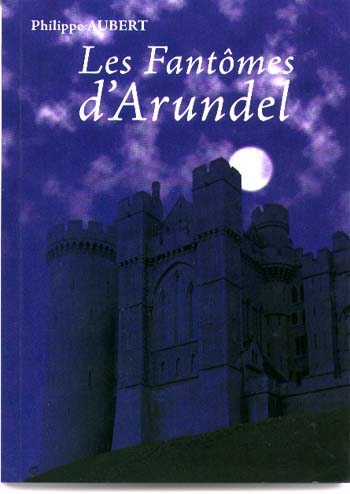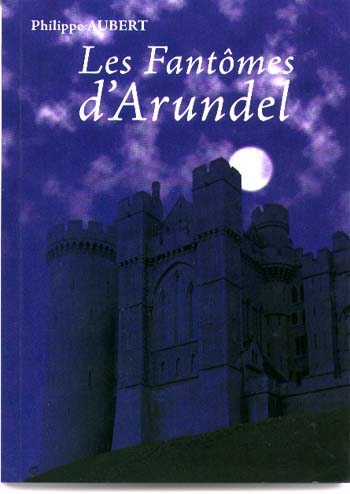
LES FANTOMES D'ARUNDEL
Philippe Aubert, Istra, Paris, 2005 *
Plutôt inattendu de la part d'un ecclésiastique français
féru d'histoire et de théologie, président du Consistoire
de l'Eglise Réformée de Mulhouse, ce roman policier de facture
très britannique se lit avec intérêt et plaisir de bout
en bout. A quel cadavre rattacher le sinistre débris humain trouvé
sur le seuil du presbytère d'une paisible paroisse du comté
d'Arundel ? Tout en vaquant aux obligations de son ministère et à
divers hobbies très distingués, le révérend James
Brown accompagne de sa sympathie l'inspecteur Alan Glen venu enquêter
sur la macabre découverte. De l'incongruité initiale au dénouement
tragique, l'intrigue est servie par des personnages captivants qui évoluent
dans des lieux pleins de charme. Le récit est d'une écriture
sobre et élégante, et les dialogues abordent avec simplicité
des questions essentielles concernant la culture et la religion. C'est bien
volontiers que le lecteur se laisse séduire par la connaissance à
la fois savante et sensuelle que l'auteur a de l'univers qu'il décrit.
Mais les fantômes d'Arundel ne disparaissent pas sans troubler ceux
qui les croisent : que se passe-t-il réellement derrière les
masques et les décors ? Une rapide analyse du livre et de ses enjeux
théologiques permet, au risque de paraître indiscrète
et réductrice, de les interroger à frais nouveaux.
Le révérend Amberley et son épouse illustrent la religion
dans ce qu'elle a de plus étroit, de plus calculé, de plus
stérile et, à vrai dire, de plus courant. Le révérend
Brown par contre se veut un homme libre et ouvert, exigeant au plan théologique
et proche de ses paroissiens. Il assume ses charges ecclésiastiques
avec sérieux et intelligence, s'adonne avec délectation à
ses loisirs préférés en appréciant la liberté
que lui ménage sa profession, et se flatte des manières émancipées
de sa femme sans se soucier du qu'en-dira-t-on. D'une vaste culture, mais
peu enclin aux engagements trop terre-à-terre, il compose avec la
religion par conviction et par la force des choses. Tolérant envers
le couple Amberley (et envers ses autres collègues sans doute), courtoisie
oblige et nécessité fait loi, il montre à l'égard
de son Eglise une indulgente compréhension non exempte d'une certaine
duplicité. Comme on ne peut échapper à bon compte à
la religion quand on en fait son métier, le statut ecclésiastique
lui pèse en même temps qu'il lui convient. Il lui est loisible
de choisir sa théologie, la version libérale en l'occurrence,
mais le patrimoine religieux et les servitudes qui l'accompagnent s'imposent.
Non sans raison, il est hanté par la crainte de finir désabusé,
entre prophètes et menteurs, dans une Eglise confisquée par
un clergé qui se sert de l'Evangile en prétendant le servir.
Un terrible texte d'Anthony Troloppe, écrit en 1857, ne le quitte pas
**…
Aux antipodes des dévots, les principales héroïnes du
roman n'ont cure du moralisme religieux et vivent comme il leur plaît.
Elles sont jeunes et séduisantes, à l'inverse de Sarah Amberley
et Sarah Tempelton, sans âge et insipides. Patt et Debra, l'épouse
de Brown et son amie, sont des femmes sensibles et cultivées, libérées
et attachées à leur indépendance, sans progéniture
et sans travail ou du moins sans entraves en ces domaines, et on les imagine
jolies en plus. Elles ont incontestablement de la présence, mais
leur influence ne semble guère dépasser le cadre des relations
domestiques. C'est que les "filles", affectueusement appelées ainsi
par l'auteur, sont imaginées à travers les fantasmes et les
idéaux des hommes : plaisantes créatures baroques, aimablement
fantasques, mais cultivant la distinction qui sied à leur appartenance
sociale et dévouées au sexe fort. De fait, avec le brillant
libraire Richard Boswell, célibataire, et la police traditionnellement
attachée aux valeurs viriles, l'univers du roman est à nette
prédominance masculine. On n'y rencontre pas de femmes vraiment adultes
et partenaires, et pas d'enfants (sauf à travers la mention de quelques
gamins sales et obèses qui braillent…). Plus décorative qu'impliquée
dans les réalités, la féminité est complaisamment
exhibée, mais elle n'occupe qu'une place subalterne et l'image qui
en est donnée contribue pour beaucoup à imprimer une tournure
mondaine à cet écrit.
Glen, Betty et Kitty sont sans doute les personnages les plus attachants
du roman, et ceux qui soulèvent le plus de questions. Loin de l'élitisme
un peu dilettante du cercle des Brown, ils partagent la condition commune
de leurs contemporains. L'inspecteur et son adjointe ont, à l'opposé
des arts du discours et du luxe, un métier qui les occupe sans désemparer
à des tâches souvent ingrates ; et Kitty, une amante occasionnelle
de Glen, est proche d'eux jusque dans son désarroi, bien qu'elle
soit sans qualification et sans emploi régulier. Passionné
par sa profession qu'il exerce avec flegme, Glen est d'une grande sensibilité
sous des dehors peu démonstratifs, manifeste autant de largeur d'esprit
que de lucidité, et n'est dénué ni de l'ambition ni
de la réserve qu'il faut pour réussir. Mais en dépit
des rêves qui l'habitent, il semble prisonnier des contraintes d'un
quotidien médiocre et sans perspectives. Peut-être est-il blessé
par un passé qu'il ne livre pas, et se cantonne-t-il dans l'éphémère
pour se protéger. Betty et Kitty, issues d'un milieu modeste, voire
misérable dans le second cas, sont handicapées par une histoire
familiale et personnelle qui les poursuit et les voue à la monotonie
harassante des embarras journaliers, très en deçà de
leurs aspirations profondes. La fin de Kitty rappelle de manière
particulièrement abrupte et cruelle le tragique de ces existences
effacées : tandis que Glen boucle avec succès son enquête
et que son estime pour Betty le rapproche d'elle, c'est en tant que cadavre
que Kitty lui reste dans les bras après qu'il l'eut aimée sans
pouvoir le lui dire.
Les deux univers ainsi dépeints évoluent sur des orbites
séparées que les meilleures intentions de Brown ne parviennent
pas à rapprocher vraiment. Le monde des nantis flotte comme en apesanteur
à la surface de celui des humbles. En haut, des hommes cultivés
et reconnus, des femmes ravissantes et douées, un mode de vie raffiné
et une religion choisie, avec piétisme ou théologie en option.
Vêtements de marque, livres et musique, équitation et golf,
whiskies et havanes, vins recherchés et mets exceptionnels, tableaux
de maîtres et voitures de collection, parcs et châteaux, etc.,
que souhaiter de plus pour substituer un monde plaisant à la vulgarité
régnante ? En bas, un vide assez terrifiant sous les apparences plus
ou moins rassurantes de l'existence routinière. On peut aussi y avoir
envie de Dieu et même le sentir proche par moments, mais la religion
est perçue comme accessoire et le malheur est omniprésent.
L'existence relève surtout de contingences triviales qui engluent,
dans l'anodin quand ce n'est pas dans le sordide, ceux qu'une incompréhensible
prédestination condamne à ce sort. Mélancolie et nausée
l'emportent. La description de la maison de retraite est à cet égard
d'un réalisme saisissant : image extrême de la vie quelconque
et d'une survie inutile, sans issue, lieu de la déchéance incontournable
où rôde la mort, que le révérend Brown frappé
de mutisme ne pourra que fuir. On comprend aussi que l'ecclésiastique
ne suggérera pas à Glen d'aller annoncer "l'évangile
de la résurrection" aux parents de Kitty suicidée…
Quels sont, en fin de compte, les horizons de foi et d'espérance
sur lesquels ouvre ce roman ecclésiastique qualifié de polar
théologique dans certaines recensions ? Où et par quels dons
se révèle la présence divine ? Perplexe, le lecteur s'interroge.
Comment les promesses dont sont riches les vies de Glen, de Betty et de leurs
semblables pourront-elles se réaliser au modeste niveau qui est le
leur ? Le désespoir de Kitty restera-t-il à jamais sans consolation
? Loin des mondanités profanes et religieuses, des faux paradis du
luxe et des gloires de l'histoire, la navrante opacité de la vie des
humbles attend que se dévoile quelque chose du mystère de la
rédemption et du Royaume annoncé… De son côté,
le révérend Brown ne doute-t-il pas en son for intérieur
de voir un jour se concrétiser, en lui et chez ses paroissiens, cette
libération qu'il prêche trop habituellement en vain ? L'esthétique
et la culture n'étant pas à même, sauf en de rares occasions,
de porter la Parole aux déshérités à qui elle
est destinée en priorité, comment peut-il transmettre la foi
chrétienne et l'incarner dans sa vie en la partageant avec les malheureux
? Certes, il admet que l'Eglise n'assume plus les mêmes fonctions que
par le passé et qu'elle se discrédite en continuant à
se payer de mots. Mais ne sachant que faire et n'osant pas se risquer dans
l'inédit, il se résigne à tenir de son mieux le rôle
social qui lui est dévolu et se raccroche aux gratifications intellectuelles
et artistiques, sans en oublier quelques autres plus tangibles. Les paroisses
survivent tandis que l'avenir humain de Dieu se joue de plus en plus ailleurs,
et que la multitude s'épuise dans un monde triste et dur sous un ciel
vide. L'ordre des choses impose son règne et le décorum masque
la morne réalité des plaisirs frivoles comme du mal-être
commun ; l'amour s'est perdu et l'impasse s'avère totale.
Un gouffre sépare l'ordinaire du sublime, mais celui-ci n'est qu'un
leurre n'offrant aucun accès au salut lorsque, privilège d'une
minorité, il se réduit aux valeurs chères aux milieux
cultivés. Les discours théologiques les plus érudits
et les prestations artistiques les plus admirables se révèlent
impuissants à faire advenir Dieu parmi les hommes par la seule médiation
des savoirs et des émotions réservés aux meilleurs.
Et le remède à cette situation ne saurait consister en une
simple promotion culturelle moyennant une gestion améliorée
des rapports entre les esprits éclairés et les autres. Une
imposture habile à se dissimuler est ici à l'œuvre, obstinée,
impitoyable, et à terme mortelle pour tout le monde : les mystifications
générées par les privilèges occultent l'engloutissement
des pauvres dans une béance anonyme désertée par le
sens et la religion. Alors, de quel face à face radical entre terre
et ciel renaîtra la Parole à la fois capable de racheter et
de transfigurer la vie méprisée des humbles, et d'ouvrir les
yeux et le cœur des nantis ? Peut-être faudra-t-il, pour émerger
des ténèbres, de la médiocrité et des illusions
présentes à Arundel comme partout, affronter et traverser de
part en part les abîmes de l'insignifiance, de l'inanité et
de l'artifice en renonçant aux palliatifs qui entretiennent la routine
et aux idoles qui servent à la légitimer. Pour sa part, Albert
Schweitzer dont la passion pour la recherche et l'art a été
des plus fécondes, et dont Philippe Aubert aime à célébrer
la mémoire, estimait que Dieu n'est réellement accessible que
dans le service modeste et désintéressé des hommes,
et d'abord des plus démunis ***.
En nous éloignant d'autrui, la mélancolie romantique invoquée
en exergue de l'ouvrage **** n'offre qu'un refuge illusoire, sans consolation
réelle pour ceux qui sont dans le malheur. Le propos de Lord Byron
pourrait donc, même si cela paraîtra fade et désuet à
certains, être retourné comme suit : "Oh lis, j'aimerais te
contempler avec le regard porté sur toi par Dieu en ce matin où
il t'a créé, pour reconnaître à travers ton image
l'innocence et la splendeur qui transfigureront toutes les flétrissures
et sauveront le monde, et pour obtenir de coopérer à cette
rédemption." Gabriel Vahanian, pour citer un autre théologien
cher à l'auteur du roman, dirait que la vie vaut d'être vécue
dans le monde tel qu'il est, pour le changer : c'est là et dans nul
autre lieu imaginaire que résident pour nous la gloire de l'homme
et la gloire de Dieu.
Jean-Marie Kohler
* Disponible auprès de l'auteur (Tél. 03 89 42 38
95), ou dans les librairies Oberlin (Strasbourg) et Bisey (Mulhouse) ; 128
p., 12 euros.
** "Il n'y a peut-être pas plus grande épreuve, aujourd'hui,
pour les hommes des pays libres et civilisés, que d'être forcés
d'écouter un sermon. Seul le prédicateur a, dans ces contrées,
le pouvoir d'astreindre son public à l'immobilité, au silence
et à la torture. Seul le prédicateur peut proférer
avec délectation lieux communs et truismes et leur contraire, tout
en se voyant gratifié, privilège incontesté, d'une
attitude respectueuse, comme si de ses lèvres tombaient des paroles
d'une éloquence passionnée, d'une logique convaincante. (…)
Personne ne peut se débarrasser du prédicateur. Il est le
raseur de notre temps, le cauchemar qui perturbe notre repos dominical, le
mauvais rêve qui rend notre religion lourde à supporter et désagréable
le service divin. Nous ne sommes pas forcés d'aller à l'Eglise
! Non, mais nous voulons (…) ne pas être forcés de ne pas y
venir. Nous (…) sommes résolus à jouir du réconfort
du culte public, mais nous désirons aussi pouvoir le faire sans subir
cet ennui que la nature humaine ne peut normalement pas supporter avec patience,
pouvoir quitter la maison de Dieu sans cette envie de fuir que provoque ordinairement
l'ordinaire sermon. "
A. Trollope, Les Tours de Barchester
*** D'aucuns ont perçu un clin d'œil providentiel, d'un humour anglais
plein de malice…, dans la conjonction, lors de leur présentation
en librairie le 26 novembre 2005, des "Fantômes d'Arundel" et de la
correspondance d'Albert Schweitzer avec Hélène Bresslau ("Correspondance,
1901-1905, L'amitié dans l'amour", Edit. Jérôme Do Bentzinger,
Colmar, 2005).
Citation de Schweitzer figurant au dos du recueil de lettres :"Et je veux
me débarrasser de cette vie bourgeoise qui pourrait tout tuer en
moi" ! Est-il sûr que le danger identifié en 1905 se soit dissipé
depuis, rendant du coup vain le type d'engagement radical choisi par le théologien
?
**** "Au lis. Avant que le vent disperse tes feuilles, arrête, emblème
prétendu de l'innocence, et donne-nous, du moins en te flétrissant,
la leçon que ton déclin offre aux hommes."
Lord Byron